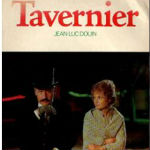
Extraits d'un entretien avec Tavernier
(Le scénario d'Un Dimanche à la campagne a été écrit par Bertrand et Colo Tavernier mais s'inspire d'un roman de Pierre Bost. Au début de sa carrière de réalisateur, Tavernier a souvent travaillé avec ces deux scénaristes.)
Pourquoi teniez-vous tant à Aurenche et Bost qui venaient d’être rayés de la carte du cinéma français par la Nouvelle Vague ?
Ce qui m’intéressait dans Bonny et Laffont*, ce n’était pas seulement les gangsters de la rue Lauriston, mais tous les gens qui grenouillaient autour, les banquiers, les gros commerçants. Et je cherchais à connaître des gens qui aient vécu cette période. J’ai pensé à Aurenche et Bost à cause de La Traversée de Paris, qui reste le meilleur film sur la période. Je me suis fait projeter un grand nombre de films dont ils avaient écrit le scénario. Je me suis rendu compte que leur travail était d’un grand modernisme. Rien de comparable avec les scénarios « brillants » d’Henri Jeanson, qui cultivait le mot d’auteur giralducien. J’ai trouvé aussi chez eux un sens de la polémique, une agressivité, un engagement libertaire qui me plaisaient bien. Ils ont toujours été pour les pauvres, contre l’armée, contre l’Eglise. Il y a dans Dieu a besoin des hommes des choses d’un anticléricalisme incroyable. Ils n’avaient pas attendu Mai 68 pour découvrir qu’il fallait mettre des éléments politiques dans les films. Dans Douce, par exemple, qui est un pur chef d’œuvre, Marguerite Moreno déclare en sortant d’une visite chez les pauvres : « Patience et résignation, alors que Roger Pigaut prône à ces mêmes déshérités : « Impatience et révolte ». C’était en 1943, et le social n’était pas encore à la mode.
…
Et que pensez-vous des critiques qui parlent de « cinéma classique » à propos de vos films ?
Mes films sont classiques en apparence. Mais j’espère qu’en dedans ils sont remplis de dissonances. (…) Dans mes trois, quatre premiers films, il est vrai que j’ai d’abord essayé de coller au scénario, à l’histoire, aux personnages. Mais après j’ai évolué. Je fais en sorte que le film auquel je m’attaque me pose des problèmes de mise en scène différents des précédents, d’affronter des choses qui sont très loin de moi. Ce qui me touche de plus en plus, c’est le rapport entre le plan et le plan suivant. Les problèmes de narration : comment briser le rythme interne d’un film, casser la dramaturgie. Comment, tout à coup, décoller. Depuis quelques temps, je commence mes tournages en me disant : « Celui-là, je vais le tourner entièrement en plans fixes, sans jamais bouger la caméra. » Au bout du second ou troisième jour de tournage, je ne peux m’empêcher de faire un immense mouvement d’appareil pour essayer d’aller au-delà, de lancer le lyrisme, de prendre l’émotionnel à bras le corps. Dans Une semaine de vacances et Un dimanche à la campagne, j’ai osé adopter une liberté de narration que l’on n’a peut-être pas remarquée mais à laquelle je tiens, passer du présent au passé avec une extrême rapidité, sans que le spectateur puisse s’y attendre. (…) Une partie de mes recherches tient d’ailleurs à l’impact de la musique, que j’écoute tous les matins en me rendant sur le tournage, et que je fais écouter aux acteurs. Je tiens aussi beaucoup aux décors. J’ai besoin d’avoir des paysages qui m’inspirent, qui alimentant les émotions. (…) Je n’ai pas le souci de mettre le décor en valeur, mais l’inverse : de ne pouvoir séparer le personnage de son décor.
…
Comment vous y êtes-vous pris pour trouver au niveau pictural un accord entre votre film et vos souvenirs ?
Je tenais absolument à éviter les références à l’impressionnisme. Avec Bruno de Keyser, nous avons évité les longues focales, travaillé sur la profondeur de champ, et cherché longuement afin de retrouver certaines teintes, une atmosphère précise. Je voulais des zones d’ombres secrètes à côté du plein soleil, car dans toute maison rêvée par un enfant, il y a toujours des cachettes. On a utilisé un procédé de laboratoire qui supprime certaines couleurs, en atténue d’autres, augmente les noirs et les blancs. Les roses et les rouges s’éteignent, tirent vers l’ocre, le brun. Les bleus disparaissent. (…) Moi je voulais retrouver les teintes des autochromes. On a fait énormément d’essais avec des bains plus ou moins colorés, des filtres, des maquillages…Et à partir de là, on a décidé quelle serait la couleur dominante de chaque pièce, le maquillage approprié à chaque moment de la journée. Il fallait aussi que chaque objet ait une grande présence. C’est très important pour moi de relier les personnages à leur environnement. C’est pour cela que nous avons été fidèles à un style de mouvements d’appareils qui ne se contente pas de regarder le décor (j’ai horreur des films d’antiquaires) mais qui le relie aux personnages. Je voulais éviter aussi qu’on dise : « Ah ? C’est comme un tableau ! » Surtout, pas de composition. Dès qu’il y a une composition qui se profile, la caméra file ailleurs, quitte les personnages ou les précède. Cette hantise de la composition date Des enfants gâtés. Depuis ce film, j’ai essayé de lutter contre la symétrie. Je crois que je n’ai plus fait de scènes en champ-contrechamp, ou alors avec des optiques différentes. Jamais un plan qui en amène un autre de façon automatique. (…)
…
Comment avez-vous choisi les tableaux qui sont chez [M. Ladmiral] et dans son atelier ?
Les plupart appartiennent à l’Ecole lyonnaise. Je les ai trouvés à la galerie Le Lutrin, chez un ami de Bernard Chardère. Je les trouve magnifiques. Ils sont souvent décalés par rapport à l’impressionnisme, surtout dans le choix des sujets. (…) Les toiles de l’Atelier qui représentent Sabine ou la famille ont été peintes spécialement par Jean-Pierre Zingg. (…) Et puis il y a un tableau de Louis Ducreux. C’est lui qui a eu l’idée qu’on retrouve un vieux tableau dans le grenier. Et comme il était l’auteur du tableau, qu’il était fou de sa toile, il voulait à tout prix qu’on le voie bien. (…)
...
Lors de la scène de la guinguette, M.Ladmiral fait une confession qui pourrait dépasser le personnage.
Je crois que lorsque Pierre Bost écrivit ce passage, il parlait de lui. C’était un homme modeste, et d’une pudeur protestante. Il avait eu quelques succès, il avait écrit des pièces qui avaient été interprétées par Jouvet, il avait été reconnu par Queneau, Giono, Marcel Aymé. Mais il se considérait comme un raté. Il avait le sentiment d’être passé à côté d’un mouvement… Dans le film que j’ai fait sur lui, Soupault enfonce le clou : « Bost est devenu plus ou moins raté en faisant du cinéma », dit-il à Aurenche. Etre scénariste, même très connu, c’est être un raté de la littérature. Bost en était très conscient et il ironisait sur lui-même. Y compris sur son aspect physique. Car ce personnage qui ressemble tant à Paul Valéry, c’était presque lui. Il avait été libéré par les Allemands pour « maigreur effrayante ».
...
Et les petites filles qui jouent dans le jardin ?
C’est une image d’enfance qui surgit périodiquement. Je m’en suis servi comme une façon poétique d’amener l’idée de la mort. Dans Que la fête commence, il y avait déjà une fillette en train de s’amuser pendant que l’on préparait l’échafaud. Et dans La mort en direct, une autre qui sautait à la corde dans le cimetière.
Extrait de TAVERNIER, de Jean-Luc DOUIN, Edilig, 1988
*Projet non abouti de film sur la gestapo française
Deux compléments:
Pour en savoir plus sur les autochromes Lumière...
Un autre entretien avec Bertrand Tavernier
